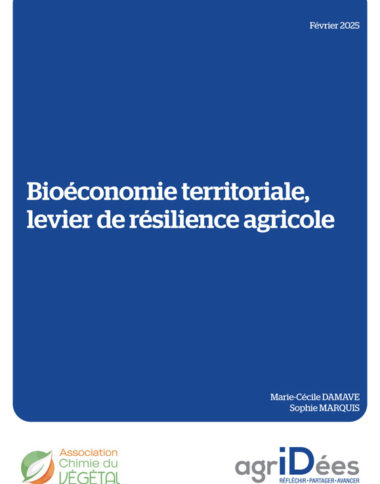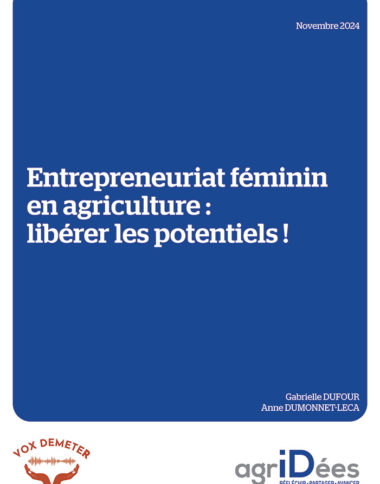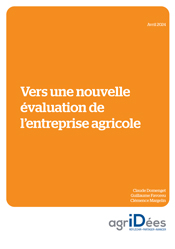Notes
Temps de lecture : 3 min
21/02/2025
Bioéconomie territoriale, levier de résilience agricole
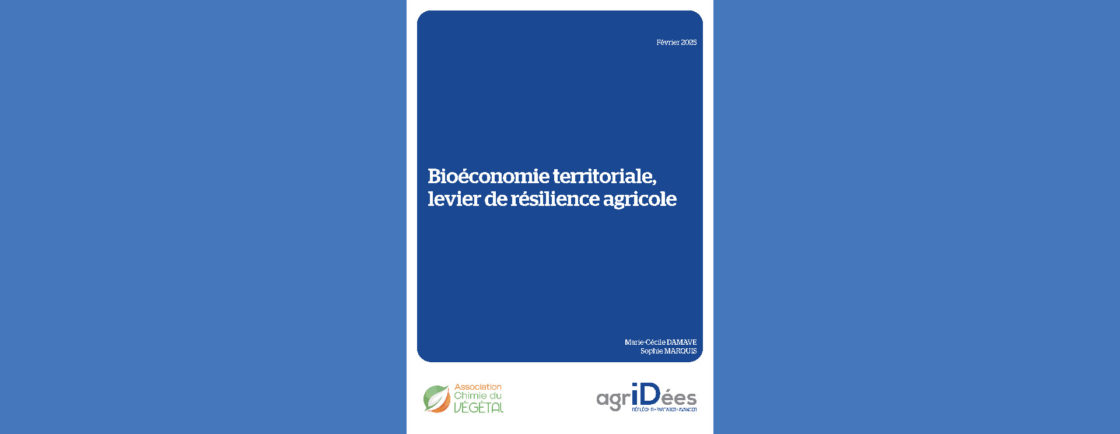
Fruit d’un groupe de travail coanimé par l’Association Chimie du Végétal (ACDV) et Agridées, cette nouvelle Note de think tank met en lumière les conditions de réussite d’une transition bioéconomique, reposant sur la complémentarité et l’interdépendance entre les valorisations alimentaires (humaine et animale) et non-alimentaires (énergies, matériaux et chimie) des biomasses agricoles. Les entreprises agricoles, et les agriculteurs en particulier, doivent aujourd’hui renforcer et diversifier leurs engagements dans la bioéconomie circulaire ancrée dans les territoires, pour être résilients face aux enjeux actuels.
Version anglaise : infographies et synthèse de 4 pages
Résumé
Certains acteurs du monde agricole (agriculteurs, entreprises de l’agroalimentaire et de l’agro- industrie, interprofessions) se sont engagés dans la voie de la bioéconomie (économie biosourcée) depuis plusieurs décennies. La réussite de certains projets de filière a permis de démontrer la complémentarité et l’interdépendance entre les valorisations alimentaires et non-alimentaires des biomasses agricoles. De multiples bioraffineries (nées de synergies entre agriculture et industrie) ont vu le jour, souvent grâce à des investissements importants du monde agricole, et en particulier des coopératives. Les filières biocarburants (biodiesel et bioéthanol) sont des exemples de filières structurées, associant valorisations alimentaires (humaine et animale) avec les valorisations énergétiques. Plus récemment, les unités de méthanisation agricole se sont développées comme de petites bioraffineries en « circuit court », impliquant directement les agriculteurs dans la production de biogaz et avec une dimension circulaire de retour au sol du digestat. Forts de ces expériences, les acteurs du monde agricole, et en particulier les agriculteurs, doivent aujourd’hui renforcer et diversifier leurs engagements dans la bioéconomie circulaire et territoriale, pour relever les défis qui s’accumulent. Il n’est plus seulement question de sécurité et de souveraineté alimentaire, mais également énergétique et industrielle face à l’instabilité géopolitique, de décarbonation de l’économie pour répondre aux dérèglements climatiques, d’attractivité des métiers face à la déprise agricole et de perte de sens face aux remises en question imposées par la société. C’est donc bien de résilience qu’il s’agit, pour l’ensemble de la sphère agricole et pour chaque agriculteur en particulier, afin non seulement de résister à ces épreuves et sortir du malaise ambiant, mais aussi en sortir plus forts et sur la durée. Pour cela, une « transition bioéconomique » réussie est possible, mais sous plusieurs conditions. En premier lieu, les politiques publiques incitatives doivent être plus cohérentes entre elles et avec les disponibilités en biomasses. Les incitations à la production et à la consommation de biomatériaux et de molécules biosourcées doivent être renforcées, par exemple, en mettant en avant les propriétés intrinsèques apportées par les biomasses agricoles des territoires, et en informant les consommateurs de ces caractéristiques. De plus, la recherche et le développement doivent être renforcés en matière d’innovations technologiques (process) et fonctionnelles pour que le biosourcé gagne en compétitivité avec le pétrosourcé. Ensuite, si la demande en biomasses agricoles est forte pour décarboner et « défossiliser » l’ensemble de l’économie, il faudra bien assumer d’augmenter la production, dans certaines conditions, sur certains territoires, de biomasses jugées « prioritaires » : par exemple, préférer des cultures productives aux usages multiples (alimentaires et non-alimentaires) sur des terres fertiles, pour répondre simultanément à plusieurs enjeux stratégiques (souveraineté alimentaire et industrielle notamment).
Au niveau des agriculteurs, l’engagement dans la transition bioéconomique doit se réfléchir comme une stratégie d’entreprise, c’est-à-dire avec un accompagnement économique, financier, juridique et humain pertinent et en fonction des spécificités agropédoclimatiques, industrielles et géographiques du territoire. Celui-ci, en tant que bassin économique, doit comporter une demande locale industrielle (bioraffinerie) pour la transformation et sociétale (agglomération urbaine) pour au moins une partie et la consommation finale de produits, matériaux ou énergies biosourcés. Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les transformations des biomasses agricoles qui doivent générer de la valeur aux agriculteurs, dans des démarches collectives, mais également les services écosystémiques fournis par des modes de production vertueux, s’ils sont reconnus comme tels parce que quantifiés selon des méthodes reconnues (paiements pour services environnementaux, crédits-carbone, primes aux filières de l’agriculture régénératrice…). La boussole nécessaire aux chefs d’entreprise agricole pour les guider dans leurs choix devra reposer sur un outil d’aide à la décision composé d’indicateurs comptables financiers et extra-financiers. Cet outil sera particulièrement judicieux dans le contexte de l’application de la directive européenne encadrant les rapports de développement durable des entreprises (CSRD). La multiperformance des entreprises agricoles engagées dans une bioéconomie circulaire et territoriale pourra, sous ces conditions, être source de résilience.
Nos propositions
1. Produire des références territoriales pour éclairer les politiques et les acteurs économiques :
- inventorier l’offre et la demande de biomasses et les outils industriels de transformation dans les territoires selon des méthodes harmonisées au niveau européen ;
- créer un observatoire des actions valorisant les pratiques de l’agriculture durable et un suivi de ces données ;
- encourager des travaux de recherche sur de nouvelles méthodologies d’évaluation des externalités positives des produits biosourcés permettant de créer des outils de comparaison multicritère d’impacts environnementaux, économiques et sociaux.
2. Augmenter la production globale de biomasses pour répondre à la diversité des demandes :
- faciliter le déploiement d’outils de financement incitatifs (paiements pour services environnementaux, PSE, crédit d’impôt transition agricole, crédit d’impôt recherche, créditscarbone et crédits-biodiversité, primes filières de type agriculture régénératrice…) qui monétisent les co-bénéfices des produits biosourcés ;
- en cas de déprise de l’élevage liée à la progression du flexitarisme, éclairer les agriculteurs dans leurs choix stratégiques sur les impacts d’une conversion vers la production de biens et de service non-alimentaires, dans une logique de filière et de territoire ;
- préférer la production de biomasses qui ont de multiples débouchés (tant alimentaires que non-alimentaires) en portant une attention particulière au partage de la valeur entre les différents maillons de la chaîne, comme outil de gestion du risque-prix pour les agriculteurs.
3. Prioriser les projets qui ont un sens dans les territoires :
- construire un outil d’aide à la décision pour les acteurs économiques des territoires de l’écosystème agricole sur la base d’un radar multicritère visant la résilience, dans une logique de projet bioéconomique territorial, sur le modèle des projets alimentaires territoriaux (PAT) ;
- conditionner les incitations à la production de biomasse à la présence d’un outil industriel de valorisation des biomasses de type bioraffinerie territoriale, dans une logique de développement de filières ;
- afficher un plan de développement des bioraffineries agricoles favorisant l’accueil de nouveaux acteurs industriels sur des plateformes préexistantes en cohérence avec les productions locales de biomasses agricoles ;
- élargir l’analyse des projets industriels par les cellules biomasse régionales pour qu’elles tiennent compte non seulement des plans d’approvisionnement en volume mais aussi des impacts en matière de création de valeur ;
- favoriser le déploiement de bilans de comptabilité socio-environnementale (méthode CARE), pour les exploitations agricoles qui tiendraient compte de leur propre empreinte carbone et de leur engagement dans des filières de décarbonation de l’économie. Soutenir les actions déjà engagées.
4. Rendre les politiques publiques incitatives plus cohérentes et équilibrées :
- sortir de la vision polarisée alimentaire/non-alimentaire, ces productions étant intimement liées, grâce à plus de cohérence dans les politiques publiques, avec une vision holistique ;
- renforcer les niveaux d’incitation pour des valorisations en biomatériaux et chimie biosourcée (aujourd’hui moins élevées que les incitations aux bioénergies), sur la base des propriétés intrinsèques et différenciantes de ces produits (qualité, durabilité, naturalité).
5. Améliorer la visibilité des actions engagées :
- sensibiliser les acteurs agricoles et industriels à l’aide d’instances de rencontres dans les territoires (forum bioéconomie en région, salons professionnels, Salon international de l’agriculture de Paris) ;
- sensibiliser les consommateurs aux « Clean Labels » (Product Environmental Footprint européen, affichage environnemental national) tenant mieux compte des pratiques de l’agriculture durable et de la composition en carbone biogénique des produits.